 Parution : première parution en 1948 chez Calmann-Lévy. Il a été réédité dans la collection Pérennes en août 2005. Il a paru dans les éditions Le Livre de Poche en novembre 1975. Traduction de l’allemand par Fernand Delmas.
Parution : première parution en 1948 chez Calmann-Lévy. Il a été réédité dans la collection Pérennes en août 2005. Il a paru dans les éditions Le Livre de Poche en novembre 1975. Traduction de l’allemand par Fernand Delmas.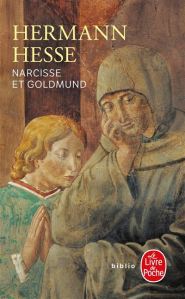
Broché : 300 pages – 23 € Poche : 383 pages – 8.90 €
Le style, le genre : roman d’initiation, histoire allégorique de la lutte chez l’homme entre la spiritualité et l’animalité, ce roman est aussi un hymne à la Nature, source d’équilibre et de joie pour Hermann Hesse. C’est un appel à trouver un équilibre dans sa vie !
L’auteur : Hermann Hesse est né le 2 juillet 1877 à Calw, en Allemagne, et mort en 1962. Il a grandi dans une famille de pasteurs protestants. Il a douze ans quand, déjà révolté contre son éducation piétiste qui doit faire de lui un pasteur, il décide de devenir poète et rien d’autre, ce que sa famille rigide et conservatrice interprète comme un signe de démence. Il a été influencé par des mouvements artistiques tels que le symbolisme et le romantisme, ainsi que par des philosophies orientales telles que le bouddhisme et le taoïsme.
Hesse atteindra son objectif : en 1946, il reçoit le prix Nobel de littérature. Ses autres œuvres : Peter Camenzind, L’Ornière, Le Loup des steppes, Le Voyage en Orient, Le Jeu des perles de verre, etc.
Les lieux : Allemagne.
L’histoire : Dans l’Allemagne du Moyen Âge, Narcisse est un jeune novice au couvent de Mariabronn, où il enseigne. Il se prend d’amitié pour l’un de ses élèves, Goldmund, et le pousse à réaliser sa destinée en lui faisant quitter le couvent. Goldmund, n’ayant aucun souvenir de sa mère, qui l’abandonna enfant, part à la recherche de la mère originelle, celle des Arts, qui unit la naissance et la mort, le bien et le mal. La vie de Goldmund le mène d’une aventure amoureuse à l’autre, mais les temps sont dangereux et la cruauté des hommes, la maladie et la mort se placent sur le chemin du jeune homme, épris d’absolu et de liberté. Narcisse, devenu grand prêtre, le guidera. Goldmund poursuivra inlassablement sa quête, celle de la mère, l’Eve éternelle car, comme il le dit lui-même : « Sans mère, on ne peut pas aimer, sans mère, on ne peut pas mourir. »
Mon avis : attention chef d’œuvre ! j’ai adoré ce livre, merci Arthur de me l’avoir offert. Pourquoi l’ai-je tant aimé ? d’abord parce que c’est un roman captivant, et parce que c’est un hymne à la liberté, attention pas à une liberté au sens où nous l’entendons communément, concept doux et sans histoire quand on a oublié comment elle se gagne. C’est à une liberté totale dénuée d’habitudes, de conventions sociales et d’un quotidien sans surprise qu’aspire Goldmund. La liberté avant tout le reste, y compris dans la douleur, et la recherche de l’irrationnel et du rêve. La puissance de la vie explose à toutes les pages.
« Comment t’appelles-tu ?
-Goldmund.
-Eh bien, Goldmund, Bouche d’or. Je goûterai si ta bouche est d’or. Écoute-moi bien. Tu présenteras, vers le soir, cette chaîne au château et diras que tu l’as trouvée. Elle ne quittera pas tes mains, je veux la recevoir de toi-même. Tu viendras comme tu es là : qu’ils te prennent pour un mendiant. Si un des domestiques te rudoie, reste calme. Il faut que tu saches que je n’ai au château que deux de mes gens qui soient sûrs : le palefrenier Max et ma femme de chambre, Berta. Tu devras les joindre l’un ou l’autre et te faire conduire chez moi. À l’égard de tous les autres, y compris le comte, comporte-toi avec prudence ; ce sont des ennemis. Tu es prévenu ; ça peut te coûter la vie. »
Elle lui tendit la main ; en souriant, il la prit, la baisa doucement, la frôla de sa joue. Puis il ramassa la chaîne et s’en alla en descendant la pente vers le fleuve et la cité épiscopale. Les vignobles étaient déjà dénudés ; des arbres, l’une après l’autre, les feuilles tombaient dans le vent. Goldmund branla la tête et sourit en apercevant à ses pieds la ville si jolie, si aimable. Il y a quelques jours, il était tout désolé, désolé même de ce que la misère et la peine fussent si éphémères. Et voilà qu’elles étaient déjà passées, envolées comme la feuille dorée de l’arbre. Il lui semblait que jamais encore l’amour n’avait rayonné vers lui comme il rayonnait de cette femme souriante et blonde, dont la haute stature, la profusion de vie, évoquaient pour lui l’image de sa mère, telle que jadis, au monastère de Mariabronn, il la gardait dans son cœur. Avant hier encore, il n’eût pas cru possible que le monde pût sembler si riant à ses yeux, qu’il pût, une fois encore, sentir le fleuve de la vie, de la joie et de la jeunesse couler à pleins bords, impétueux, dans son sang. Quelle chance qu’il fût encore vivant, que dans tous ces mois d’horreur, la mort l’eût épargnée.
J’ai pris, au début de la lecture, ce texte comme (simplement) un roman d’initiation pour adolescents et jeunes adultes, tels que nous en connaissons beaucoup (je n’ai pas pu m’empêcher de penser au Jean-Christophe de Romain Rolland), mais finalement si c’est bien à une initiation à laquelle nous sommes conviés, elle ne se cantonne pas aux premiers âges de la vie, voyez ce qui suit.
C’était vraiment honteux d’être ainsi berné par la vie ; c’était à en rire et à en pleurer ! Ou bien on vivait en s’abandonnant au jeu de ses sens, suçant au sein de l’Ève maternelle une riche nourriture, on connaissait alors mainte noble joie, mais on restait sans protection contre l’instabilité des choses humaines ; on était alors comme un champignon dans la forêt, tout resplendissant de ses riches couleurs, mais qui, demain, pourrira. Ou bien on se mettait en défense, on s’enfermait dans un atelier, on cherchait à dresser un monument à la vie fugitive : alors il fallait renoncer à la vie, on n’était plus qu’un instrument, on se mettait bien au service de l’éternel, mais on s’y desséchait et on y perdait sa liberté, sa plénitude, sa joie de vivre ; c’était le cas de maître Niklaus.
Et pourtant toute notre vie n’avait un sens que si on parvenait à mener à la fois ces deux existences, que si elle n’était pas brisée par ce dilemme : créer sans payer cette création du prix de sa vie ! Vivre sans pour cela renoncer au noble destin du Créateur ! Était-ce donc impossible ?
Peut-être existait il des hommes qui en étaient capables. Peut-être existait-il des époux et des pères de famille à qui la fidélité ne faisait pas perdre le sens de la volupté. Peut-être y avait-il des sédentaires dont le cœur ne se desséchait pas faute de liberté et de danger ? Il se pouvait, il n’en avait encore vu aucun.
Tout être reposait, semblait-il, sur une dualité, sur des oppositions. On était homme ou femme, chemineau ou bourgeois, intellectuel ou sentimental ; nulle part on ne trouverait ce rythme de l’inspiration et de l’expiration, on ne pouvait être à la fois homme et femme, jouir de la liberté et de l’ordre, vivre en même temps la vie de l’instinct et de l’intelligence. Toujours il fallait payer l’un de la perte de l’autre, et toujours l’un était aussi précieux et désirable que l’autre. »
Tout au long du texte l’opposition est constante entre ce qui relève du masculin (les idées, l’intellect) et du féminin (la sensibilité, les sentiments), sans que l’un ou l’autre soit absent de l’Essence d’un homme ou d’une femme. Le passage page 59 (du format poche), est un court extrait d’un des échanges fabuleux entre Narcisse et Goldmund.
« Supérieur à toi ! Moi ! » balbutia-t-il, simplement pour dire quelque chose. et ses traits se figèrent.
« Bien sûr, poursuivit Narcisse, les natures du genre de la tienne, les hommes doués de sens délicats, ceux qui ont de l’âme, les poètes, ceux pour qui toute la vie est amour, nous sont presque toujours supérieurs, à nous, chez qui domine l’intellect. Vous êtes, par votre origine, du côté de la mère. Vous vivez dans la plénitude de l’être. La force de l’amour, la capacité de vivre intensément les choses est votre lot. Nous autres, hommes d’intellect, bien que nous ayons l’air souvent de vous diriger et de vous gouverner, nous ne vivons pas dans l’intégrité de l’être, nous vivons dans les abstractions. À vous la plénitude de la vie, le suc des fruits, à vous le jardin de l’amour, le beau pays de l’art. Vous êtes chez vous sur terre, nous dans le monde des idées. Vous courrez le risque de sombrer dans la sensualité nous d’étouffer dans le vide. Tu es artiste, je suis penseur. Tu dors sur le cœur d’une mère, je veille dans le désert. Moi, c’est le soleil qui m’éclaire, pour toi brillent la lune et les étoiles. Ce sont des jeunes filles qui hantent tes rêves ; moi, ce sont mes écoliers… »
Pour résumer : j’espère avoir donné avec ces quelques extraits une idée la plus juste possible de la profondeur de ce texte. Il y a deux lectures parallèles possibles, les aventures de ce jeune garçon et l’aspect philosophique, c’est pourquoi il peut être lu à tous les âges et par tous.

Un très bon souvenir de lecture. À relire sans aucun doute.
J’aimeAimé par 1 personne
Ton enthousiasme est contagieux, même si ce classique m’a toujours intimidée…
J’aimeAimé par 1 personne
n’hésite pas, lecture profonde mais fluide, c’est cela un grand auteur . bonne lecture
J’aimeJ’aime
Très belle suggestion de lecture ! J’avais lu Peter Camenzind, qui m’avait beaucoup plu – une raison de plus pour lire enfin ce classique.
J’aimeAimé par 1 personne